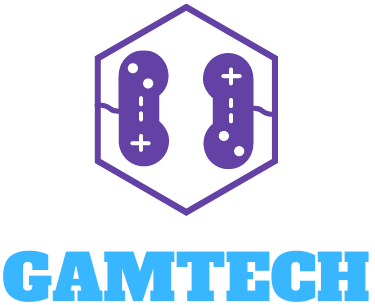Eté 1935, Mexique, port de Veracruz. Le touriste américain qui vient de débarquer rejette l’homme qui lui propose de lui apporter la malle pour six pesos. L’autre insiste. L’Américain ne cède pas et le traite de « voleur ». Une dispute s’ensuit qui attire l’attention d’un policier, tandis que l’Américain marche lentement, ruisselant de sueur, vers l’hôtel. Mais le policier le suit. Devant l’hôtel, le policier dit à l’Américain : « C’est six pesos. » Et il ajoute : « Si vous ne payez pas tout de suite, je vous jette en prison… Pour avoir exercé une profession sans y être autorisé. Sur son passeport, il est écrit touriste, pas transporteur ». L’Américain paie. Provoquer l’hilarité d’un gars qui passe, un Français.
Eté 1935, sur une petite île tahitienne. Une équipe de tournage débarque du navire. Le réalisateur américain s’approche de l’ancien Français et, le prenant pour un touriste compatriote, lui met une poignée de pièces dans la main : « À jeter ! … », il dit. Pour un Américain, ce serait beau à voir de voir les kanaks se battre pour des pièces de monnaie. « J’étais hors de moi », commentera le Français. Et il ajoutera : « Tahiti est le seul pays au monde où je n’ai jamais vu de mendiant et où auprès des gens on peut tout obtenir – sauf un travail régulier – pour quelques verres de vin ou un peu de musique ».
Ce Français à qui nous avons emprunté les citations s’appelait Georges Simenon. Le deuxième épisode rapporté fait partie de son reportage intitulé Les gangsters dans l’archipel des amoureux, aux éditions Paris-Soir ; le premier épisode est tiré d’un autre reportage réalisé sur Marianne avec le titre En marge des méridiens. Et justement, Au bord des méridiens, s’intitule le troisième recueil Adelphi de reportages simenoniens (pages 223, euro 16, traduction de Giuseppe Girimonti Greco et Francesca Scala, avec un riche éventail de photographies prises par l’écrivain), d’après Il Mediterraneo in barca, sorti en 2019, et Europa 33, sorti l’année dernière. Ici Simenon est au milieu de son tour du monde, mais, étant justement un homme du monde, il affronte aussi les scènes des mers du Sud avec le désenchantement de ceux qui en ont déjà vu tant. Par exemple, la maison de Gandhi à Bombay qui a suscité en lui une « déception », même pour les brochures annonçant sa boutique de souvenirs. Et il écrit : « Bref, voyager, c’est toujours se brûler, on détruit ses illusions. Sans exagérer, on pourrait peut-être dire qu’on voyage pour dresser la liste des pays où l’on ne voudra plus mettre les pieds ». Il n’est certainement pas un touriste bananier comme cet Oscar Donadieu qui, dans son roman de 1938, essaie à Tahiti d’échapper aux ennuis et aux soucis, pour en trouver de bien pires.
Exotisme? Mais quel exotisme… Le mépris des Américains arrogants se fait sentir partout, dans un atoll comme dans une brasserie de Montmartre. Et quant au charme des paradis terrestres… ce sera mais… soit parce que sa France des années 30 est la puissance mondiale la plus influente dans ces régions (« la fierté nationale suit la tendance de la monnaie… » dit-il lui un commissaire de bord, faisant allusion à la crise du dollar), soit parce que tout vrai voyageur se sent toujours chez lui partout où il va, ce qui soulage Simenon, au Panama comme en Equateur, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, en Australie, c’est de rencontrer des Français parmi tant d’autres. aventuriers, trafiquants, escrocs et prétendus marchands d’esclaves hors du temps. Et quand au milieu de l’océan Indien une belle dame anglaise lui demande s’il a entendu les dernières mauvaises nouvelles sur les affrontements frontaliers et les vents de guerre, il pense immédiatement à ce fou d’Hitler. Au lieu de cela : « Pourquoi parle-t-il toujours d’Hitler ? Les combats ont lieu aux Indes, et dans la région même où mon mari est en poste. Tout est relatif, n’est-ce pas ? Dans le journal radio qu’ils publient chaque jour à bord là-bas sont dix lignes sur les questions européennes, après le compte rendu des matchs de football des équipes de Sydney et de Melbourne ».
Pourtant, sur cette tournée, il y a trois endroits où même un dur comme Simenon a des frissons dans le dos. La première est la Norvège, où les pêcheurs sont souvent engloutis par les tourbillons du Maelström et où, comme le lui raconte un marin, il arrive que ceux qui restent des mois sans nourriture en pleine mer soient contraints, pour survivre, de se nourrir de le cadavre d’un compagnon mort (d’ici il puisera l’inspiration pour I survivants de Télémaque, roman écrit trois ans plus tard). Le second est l’archipel des Galapagos, d’où il envoie à Paris-Soir une mise à jour (plutôt bouleversée par le manque objectif de nouvelles fraîches) sur une affaire de crime qui, l’année précédente, 1934, avait eu un large écho également en Europe, avec un La baronne autrichienne au centre, ses deux amants, un père, une mère et son fils allemands, un médecin avec son assistante, allemande également. L’un des deux amants autrichiens et un Norvégien venu d’on ne sait où ont perdu la vie. C’est l’«Affaire des Galapagos» non résolue qui inspirera un autre noir à Simenon, Ceux de la soif, ou La soif, ou, au titre doux et trompeur, Hôtel del retour à la nature.
Et puis, et surtout, il y a Tahiti. A son arrivée, Simenon va vivre dans la maison qui avait été construite, selon les canons de la tradition locale, par le grand réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau, quand il y avait quatre ans plus tôt, en 1931, il avait tourné une partie du film Tabù ce qui fit scandale pour les seins nus des filles. Une autre tradition, voire une légende locale, celle des fantômes appelés Tupapau qui, dit-on, avaient terrifié l’acteur Douglas Fairbanks, grand et gros comme il était, s’en moque. En plus d’un sourire sarcastique il dépose la proposition d’un Suisse qui veut lui vendre la preuve certaine que Gauguin a été empoisonné par un policier… Le paysage ne l’excite pas : « Un très joli faubourg avec en plus la mer et cocotiers». Le monopole chinois des activités commerciales l’agace. Les gros Américains qui courent nus le dépriment. Les filles souriantes qui se font toucher les seins l’attirent et le satisfont, surtout lors d’une nuit très alcoolisée.
Mais le plus long frisson que Georges Simenon éprouve au moment du départ, alors qu’il a désormais compris sans le moindre doute que le Paradis sur Terre n’est même pas là, et c’est un frisson provoqué par le sentiment de culpabilité de l’homme occidental et civilisé envers d’un peuple en voie d’extinction : « Ils ont essayé de leur transmettre le goût du cinéma mais le cinéma a échoué. Ne serait-ce pas parce que, du seuil de leur maison, ils préfèrent regarder le film interminable que les blancs, ceux qui font du nudisme comme ceux qui font de la politique, ceux qui font des affaires comme ceux qui poursuivent en justice, se déversent continuellement sous leurs yeux ? Peut-être – mais je ne sais pas – est-ce cela qui les console de voir leur race mourir petit à petit ? ».



« Explorateur. Érudit de Twitter. Organisateur dévoué. Junkie extrême d’Internet. Nerd de voyage incurable. »