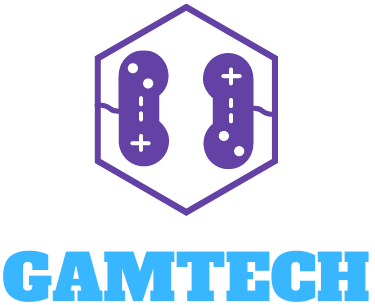Ezio Mauro raconte une histoire qu’il cultive depuis des décennies et qui a choqué l’URSS mais aussi l’Occident. C’est arrivé en 1966, lorsque les deux écrivains, le premier après Brodsky, ont enfreint la règle d’airain des procès politiques : ils ont refusé de plaider coupable, « en tout ou en partie ».
Il y a de belles histoires qu’on attrape par la queue, et puis ça revient à l’envers. Fin 1988, Ezio Mauro était correspondant de Repubblica à Moscou. Il a appris la mort de Julij Daniel, a rencontré sa famille, ne les a jamais quittés. La grande histoire s’est produite en 1966, lorsque deux écrivains, Daniel’ et Andrei Sinjavskij, ont été jugés et condamnés., à 5 et 7 ans de prison ferme, « pour activités antisoviétiques et propagande réactionnaire contre le régime soviétique ». Pour avoir écrit des livres et les avoir publiés hors de Russie – « tamizdat », est le nom russe – avec des pseudonymes : Nikolaj Arzhak pour Daniel’, Abram Terz pour Sinjavskij. Le précédent sensationnel était « Docteur Živago ». Tous deux avaient été dévoués à Pasternak et en avaient été encouragés, ils avaient apporté le cercueil. Ils ont confié leurs manuscrits à la même française qui a fait passer Živago en contrebande.
Pendant plus de trente ans, Mauro a emporté avec lui l’histoire de Daniel’, continuant à l’enrichir de nouvelles et de documents. « Si vous ne le dites pas, personne ne le saura », a déclaré Sania, le fils de Daniel. Quand une histoire est votre partenaire intime pendant de nombreuses années, vous vous l’appropriez – elle vous fait sien – vous décidez finalement de la raconter comme un roman, qui conjugue vérité des faits et fidélité des sentiments. Mauro est mû par deux impulsions décisives. La première est la sympathie pour l’homme consacré à l’écriture littéraire dont on vole le nom : pour être publié, il s’est trouvé un pseudonyme et risquait – une certitude – d’être barbarement puni. Dès lors son vrai nom deviendra imprononçable, un surnom dans les papiers des enquêteurs, un numéro dans la bière blonde, un autre pseudonyme, imposé, aux rares occasions où il pourra travailler comme traducteur, un silence et un regard écartés. chez des amis et des connaissances effrayés. L’autre point de Mauro est le choix du plus faible des protagonistes, l’élève, le plus dans l’ombre.
Il y en a deux. Pairs, ils sont nés à Moscou en 1925, à un mois d’intervalle. L’un mourra en 1988, le moins proéminent, l’autre en 1997. L’un, l’aîné, a une grande barbe tolstoïenne : un vrai Russe, il s’exilera à Paris. Le nôtre est glabre, a une cigarette aux doigts ou au coin de la bouche, a l’air français – Yves Montand pourrait le jouer dans un film : il restera toujours en Russie. Lorsque jalousies et hypocrisies politiques accusent Sinjavskij d’être devenu un dissident professionnel et de mener la belle vie, Daniel « le défendra, et avec lui la liberté de choisir où et comment écrire, sans se trahir. « Nous les avons encouragés à entreprendre la via crucis de l’exil… Nous sommes amis, nous nous sommes nourris de la même culture : celui qui a quitté le pays vivra là-bas pour nous, nous vivrons pour eux ici ».
Mauro est lui, Julij Markovičc Daniel ‘. Juif, écrivain, traducteur, poète. Blessé au front en 1944, plus grièvement au bras. Condamné à 5 ans en 1965. « N’employer que des travaux physiques lourds ». Signé le lieutenant-colonel Georgy Pavlovich Kantov, enquêteur en chef pour les questions d’une importance particulière. En prison et dans le camp, il gagne la solidarité des prisonniers ordinaires, qui étaient d’abord prêts à se moquer de lui et à l’exclure comme un privilégié. Cela suffit à lui assurer une nouvelle détention une fois sa peine purgée. Enfin, il pourra se rendre temporairement à Moscou avec un permis qui n’indique pas quand il devra rentrer, de sorte que le KGB sera plein, tant en concessions qu’en déchets. L’URSS de ces années-là tire les freins après avoir un peu succombé au dégel. C’est le pire moment, quand une manière d’exercer la tyrannie est vouée à l’échec, mais elle est encore capable de faire beaucoup de mal à ses sujets. Sinjavskij et Daniel « ont été les premiers après Brodsky à briser la règle d’airain des procès politiques : ils ont refusé de plaider coupable, « en tout ou en partie ».
Colonel juge d’instruction : « De quoi parles-tu ? ». Daniel’ : « Il s’agit d’un secrétaire de comité provincial du parti qui se transforme en chat. » « Chat? ». « Oui, c’est une œuvre humoristique et grotesque. Aussi Boulgakov parler d’un chat ».
Leur plus grande force réside dans la cause littéraire et poétique, plutôt que politique, qu’ils revendiquent. Michail Šolochov, qui vient de recevoir le Nobel en 1965, sera couvert de honte dans les accusations portées contre eux, pendant le procès et pire lorsqu’ils seront dans les tourments du camp de concentration. Par infamie, il les insulte mais ne prononce pas non plus leur nom. Il se moque de lui-même : « Dans chaque troupeau il y a un mouton noir… », mais ici les moutons noirs sont deux (cependant « Le placide Don », dira Daniel’ à son fils, est un beau roman…). D’autres et d’autres seront à leurs côtés, et paieront souvent cher leur fidélité.
En Occident, « l’affaire Daniel’-Sinyavsky » a été exemplaire. Le procès était officiellement « public », effectivement fermé à la presse étrangère et aux observateurs non inféodés au parquet (Glasnost, c’était le nom de la publicité des procès…). Même en Italie, où l’intrépide « Livre blanc » écrit par Aleksandr Ginzburg à partir des notes prises au procès par les épouses de l’accusé a été publié par Jaca Book (mérite : « La vie et le destin » viendrait en 1984) déjà en 1966. Une solidarité évidente est venue d’écrivains comme Herling et Silone, également de Moravie, de magazines comme Tempo Presente, de cercles et de personnalités chrétiennes – en particulier Sergio Rapetti, issu d’une biographie familiale dramatique – et aussi de la gauche, comme le Livourne -né et Pisan d’études (résidant maintenant dans le Trentin) Piero Sinatti … Mat, sinon pire, le PCI, à très peu d’exceptions près (notre Lisa Giua Foa avait surtout souffert pour Boukharine). Au Parti socialiste, une tendance libertaire s’était maintenue et 1956 avait servi à rendre le prix Staline : mais la Biennale de la dissidence était loin. Dans la soi-disant nouvelle gauche, encore en incubation, les dévotions soviétiques persistaient en grande partie, la répudiation radicale prévalait chez un autre, lecteur de « Ténèbres à midi » et « La révolution trahie », antistalinien d’emblée, et pourtant distrait par dissidence et stupides sur eux-mêmes : nous ne pensions pas seulement qu’ils ne pouvaient pas gagner, nous pensions que nous pouvions gagner, même pour eux… de cette solidarité). Plus d’un demi-siècle plus tard, cette histoire a une actualité tortueuse, dans le prix Nobel pour Dmitrij Muratov de Novaya Gazeta, qui l’aurait volontiers confiée à Alexei Navalnyj, et dans le prix Sakharov, elle est en fait allée à Navalnyj. Et aussi dans le raisonnement sur les statues : la dissidence soviétique est née autour des statues de Maïakovski et de Pouchkine.
Giuliano Ferrara a bien exprimé l’admiration et le plaisir littéraire avec lesquels il lisait Mauro, et cela me suffit aussi. Que je trouve dans ce livre une grande étape dans sa production colossale, désormais fomentée par l’engagement journalistique moins pressant. Mauro a une généalogie politique qui part de l’état civil et des premiers pas : Dronero, Cuneo, Norberto Bobbio, Nuto Revelli… Une passion « actionnariale » : mais l’actionnariat était composite, et Mauro s’accrochait à l’âme « non anti-communiste », ce qui devait lui sembler le bon moyen d’évaluer la part des communistes dans la reconquête de la liberté et de l’émancipation sans céder à l’idéologie et encore moins à sa réalisation totalitaire. Une grande partie de son engagement récent a profité des anniversaires, et de la combinaison de la presse et des films, pour régler les comptes avec le XXe siècle de la Révolution russe, toujours avec l’air du grand chroniqueur, et avec le 1921 de Livourne – un retour à Turati, pour aller à la dure. Dans ce livre, qui est donc un roman, la perspective est renversée, et l’histoire respectable des manuels sert à comprendre les pensées, les douleurs, le courage et la lassitude d’un homme qui aimait beaucoup les siens, les femmes, la forêt. et littérature. Mauro, son auteur, avait un atout : l’amour de l’écriture, l’intelligence du désir de se faire un nom.



« Explorateur. Érudit de Twitter. Organisateur dévoué. Junkie extrême d’Internet. Nerd de voyage incurable. »